Ouvrage de la Ferté.

L’ouvrage de La Ferté est un ouvrage fortifié de la ligne Maginot situé sur les communes de Villy et de La Ferté-sur-Chiers, dans le département des Ardennes.
Dans le projet initial, un ouvrage mixte (d’infanterie et d’artillerie) devait être construit à Vaux-lès-Mouzon, entre Carignan et Mouzon, couvrant ainsi les arrières de l’ouvrage de La Ferté. Pour des raisons budgétaires, cette construction est abandonnée, laissant le soin de la défense des abords aux troupes d’intervalles. Le « petit ouvrage de La Ferté » devient, ainsi, le dernier maillon de l’extrémité nord de la ligne Maginot, pour la partie dite continue de cette ligne Maginot. Par rapport à une telle position, sa puissance de feu est relativement réduite. Par ailleurs, l’ouvrage ne possède aucune arme à tir courbe. Les mortiers de 50 mm adaptables aux rotules des cloches et aux créneaux de fusils mitrailleurs n’avaient pas été installés à cause de l’absence de leurs supports. Ces armes auraient permis de battre la route de La Ferté à Villy traversant la colline dans une tranchée profonde. La géographie du terrain permet en effet l’approche des troupes ennemies jusqu’au réseau de barbelés situé à soixante-dix mètres.
Le 18 Mai 1940, l’ouvrage de La Ferté est pris à partie par l’artillerie allemande. Les assaillants ont réuni de gros moyens d’artillerie, près de 250 canons, dont quatre redoutables pièces de 88 mm qui s’en prennent aux cloches du bloc 2 en tir direct, ainsi que des mortiers lourds de 210 mm.
La tourelle AM à éclipse reste bloquée en position intermédiaire après son utilisation pour faire de l’observation: il est impossible de la redescendre !
Les pionniers (génie militaire allemand) attaquent à 19 h 20, aidés par la fumée et par les trous d’obus. Ils parviennent sur les dessus du bloc 2 dont les cloches sont neutralisées par des charges explosives placées contre les créneaux. Une charge très puissante est plaquée contre la muraille de la tourelle. À la suite de l’explosion, la tourelle se retrouve en porte-à-faux (état actuel) et les Allemands peuvent alors lancer des grenades et autres charges explosives à l’intérieur du bloc qui entraînent la panique chez ses défenseurs. Des incendies se déclarent et les hommes gagnent par les dessous, la galerie de liaison souterraine. Mais les portes formant un sas, censées isoler le bloc 2 et la galerie, ne sont pas fermées, permettant aux fumées nocives d’envahir progressivement la galerie.
Les cartouches de masque anti-gaz manquent progressivement et ne sont pas adaptées à la situation : faits pour protéger des gaz de combat, ypérite, phosgène, produits chlorés, ils ne peuvent rien contre le monoxyde de carbone dégagé par les incendies et la raréfaction progressive de l’oxygène.


Au début du mois de juin 1940, les portes blindées de l’ouvrage de La Ferté s’ouvrent. En pénétrant dans les blocs de combat encore envahis par les fumées, les Allemands découvrent surpris, l’inexplicable ! En effet, ils n’avaient pas imaginé la formation du monoxyde de carbone, et son effet dévastateur !
Des 105 membres de l’équipage du lieutenant Bourguignon (commandant de l’ouvrage), il ne reste aucun survivant !










Réseau de rails antichars
Le concept est basé sur le soulèvement du char au sol, qui expose ainsi ses parties les plus vulnérables aux tirs ennemies !



Blockhaus de la ligne Magino





















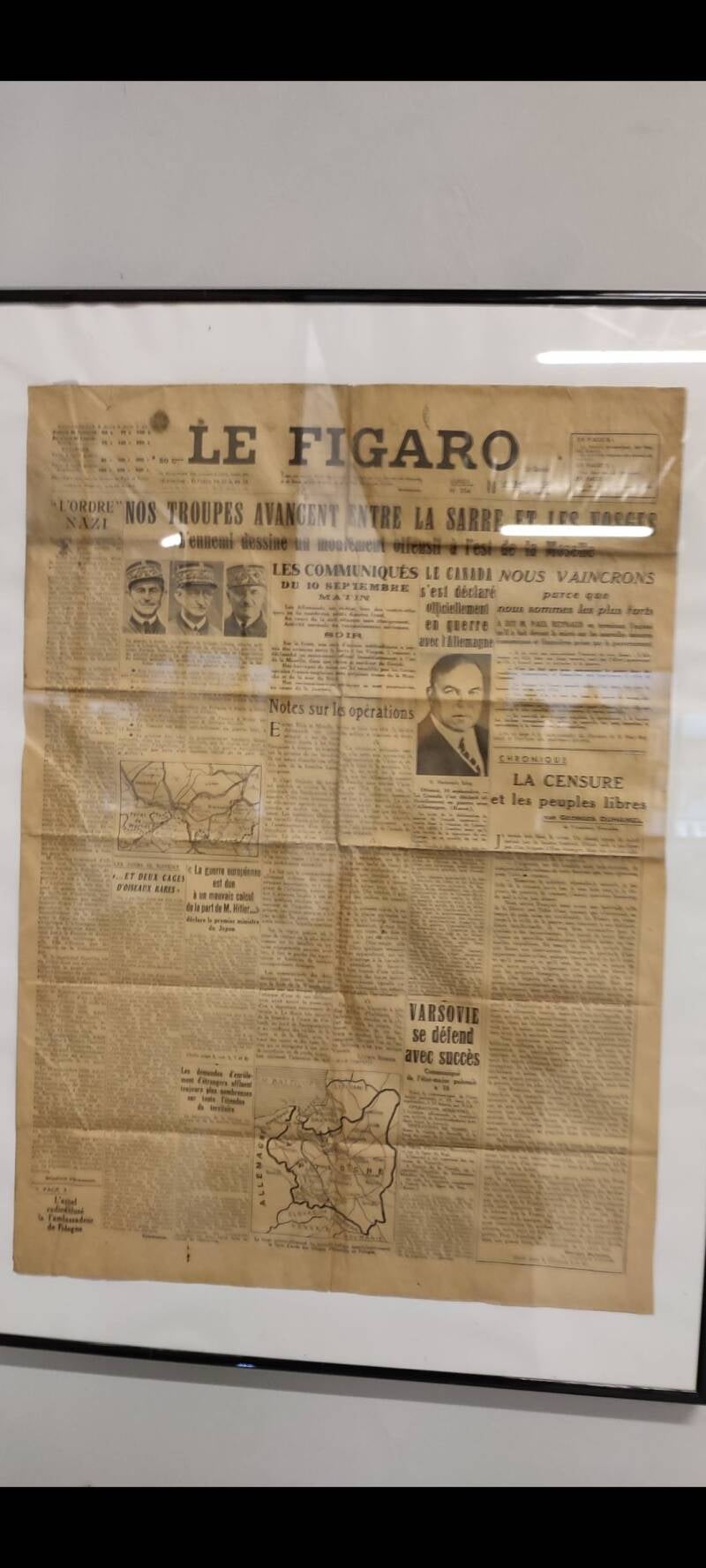























Vue du cimetière militaire du monument commémoratif. Un site rend aussi hommage à chaque soldat de La Ferté en constituant pour chacun d’entre eux un recueil de documents et de photos


Le médecin auxiliaire Hervé Fontaine mourut asphyxié avec tout l’équipage de l’ouvrage de
La Ferté (Ligne Maginot)
Le médecin auxiliaire Hervé Fontaine
On ne sait pas grand-chose sur le médecin auxiliaire Fontaine qui avait la charge de la santé des troupes d’infanterie occupant l’ouvrage de La Ferté, premier ouvrage de la ligne Maginot à l’est de la Meuse. Né le 22/02/ 1913, il avait 27 ans en mai 1940. Il provenait du département de la Manche d’un petit village appelé Blosville d’un peu plus de 300 habitants. Il était médecin auxiliaire. Ce titre était attribué aux étudiants en médecine mobilisés qui n’avaient pas encore obtenus leur diplôme. Mais Hervé était déjà âgé de 27 ans et l’on peut se demander pourquoi n’était-il pas encore diplômé. Avait-il obtenu un autre diplôme paramédical qui lui permit d’être mobilisé comme médecin auxiliaire ? Le mystère autour de la personnalité de ce jeune homme au regard lointain et énigmatique reste complet. On aimerait en savoir plus sur lui. Mais a-t-il encore à Blosville une parenté qui garde son souvenir ? Les seuls renseignements que j’ai pu collecter est que ses deux parents décédèrent en 1964.
La mémoire des hommes est décidément très courte !
C’est à cet homme, et à tous ces camarades de l’ouvrage de La Ferté que nous voulons rendre hommage.
Que de jeunes vies gâchées ! Trois défenseurs de La Ferté moururent le 18 mai lors du début de l’attaque allemande et les 102 autres membres de l’ouvrage moururent ensemble, dans la nuit du 18 au 19 mai, à 25 mètres sous terre dans une galerie sinistre, asphyxiés par le CO et les fumées toxiques ! Tous les hommes s’étaient en effet réfugiés dans la galerie quand le bloc 2, puis le bloc 1, s’étaient embrasés suite à la destruction des cloches et de la tourelle par les sapeurs allemands. Parmi les premiers morts asphyxiés se trouvait le médecin Fontaine. Chacun sait qu’en cas de menaces d’asphyxie, il faut essayer de diminuer sa consommation d’oxygène et donc, effectuer le moins d’efforts possibles ! J’imagine pourtant Hervé, dans son infirmerie ou dans la galerie se remuant comme un diable pour effectuer des soins sur les brûlés ou, tout simplement, se déplaçant d’un homme à l’autre pour l’aider à mettre son masque à gaz… Epuisé par ses efforts, il va mourir l’un des premiers…
Contexte de la tragédie : deux blocs unis par une galerie transformée en enfer
En mai 40, les Allemands décident de pénétrer en France par la vallée de la Meuse après avoir traversé la Belgique. Leur intention était ainsi d’éviter la Ligne Maginot du nord-est de la France qui était beaucoup plus achevée et puissante que les ouvrages établis de part et d’autre de la Meuse. Leur plan se révéla efficace mais ils voulurent protéger leur flanc gauche en détruisant le petit ouvrage de La Ferté, premier ouvrage de la ligne Maginot à l’est de la Meuse. Cet ouvrage était composé de deux blocs munis de tourelle et de cloches cuirassées contenant canons et mitrailleuses. La différence entre tourelle et cloche consiste en le fait que seule la tourelle peut pivoter sur elle-même et même s’élever pour augmenter son champ de tir. Seul le bloc 2 possédait une tourelle. Le bloc 1 possédait cependant en plus de ses cloches sur son sommet une chambre de tir (un bunker incorporé) chargé de défendre les abords immédiats de ce bloc. Les deux blocs étaient unis par une longue galerie souterraine de 270 mètres atteignable après avoir dévalé du bloc 2 les 167 marches d’escaliers….
Pourquoi et comment l’ouvrage de La Ferté fût-il détruit par l’ennemi si rapidement ?
Des restrictions budgétaires ont empêché la construction d’un ouvrage d’artillerie qui devait défendre son flanc ouest. De plus, on ne trouvera pas le budget pour raccorder à l’ouvrage les deux casemates d’artillerie qui empêchent l’ennemi de déferler vers les deux blocs par la route conduisant au village de Villy. Enfin, l’ouvrage ne dispose pas d’une artillerie à tir courbe permettant de tirer sur la zone à angle mort située à 100 mètres derrière le bloc 2. Ces défauts prévisibles ont été bien perçus par les Allemands qui vont les exploiter. Avec des canons Mörser de 21 cm, ils vont pilonner l’ouvrage (deux mille coups le 17 et 18 mai). Vers 14h00, la cloche du guetteur du bloc 2 est atteinte par un obus. La rotule qui maintien l’armement dans le créneau est projeté vers l’arrière et décapite le sergent Couraux. Le soldat Koester, à côté de lui est grièvement blessé à l’épaule et meurt presqu’aussitôt. Le choc fait s’effondrer la plate-forme d’armement sur laquelle se trouvaient les deux hommes. Elle tombe au bas de la cloche tuant le soldat Gomez. Ce sont les premières victimes de la tragédie.
Vers 17h00 le village de Villy, défendu par la première compagnie du 23e RIC appuyé par une section de mitrailleurs du 155e RIF (Régiment d’infanterie de forteresse) est finalement occupé par les Allemands après trois assauts infructueux ! Les sapeurs vont alors pouvoir se hisser sans être vus, via les cratères qui leur servent de tranchées, jusqu’au sommet du bloc 2. Nous sommes le 18 mai vers 18h10. Le leutnant Sommerhuber et le gefreiter Bierman poussent alors une perche au bout de laquelle se trouve une charge explosive (tolite) contre le créneau d’une cloche d’où dépasse un fusil-mitrailleur. Par le trou créé, ils balancent ensuite des charges explosives pesant jusqu’à trois kilos ainsi que des pots fumigènes. Vient ensuite le tour de la tourelle qui contient deux armes mixtes (canon anti char et mitrailleuse) Vers 19h00, le bloc 2 a cessé d’exister !
Le bloc 1 subira le même sort entre 21h00 et 22h30 le même sort ! On sait ce qui adviendra des soldats français qui vont tous aller se réfugier dans la galerie après avoir fermé les portes étanches qui les isolera du bloc 1 et de sa chambre de tir restée intacte ! Pendant la soirée dramatique, une contre-attaque française fut bel et bien lancée par le 119ème régiment d’infanterie avec l’appui de chars. Mais elle échouera après avoir causé la mort d’une centaine de fantassins français et la perte de trois chars. Fait assez incroyable, les occupants de l’ouvrage attribuèrent leurs dégâts à l’artillerie allemande et n’imaginèrent pas un seul instant que l’œuvre de destruction était celle de sapeurs allemands parvenus au-dessus de leurs blocs.
3. Le commandant de l’ouvrage, le lieutenant Bourguignon, 33 ans devant un dilemme crucial
Les deux blocs détruits par l’ennemi, fallait-il faire sortir les hommes de la galerie et abandonner l’ouvrage ? Le lieutenant Bourguignon en demanda, par téléphone, l’autorisation plusieurs fois à ses chefs entre trois heures du matin et trois heures quarante-cinq mais sans succès. Le lieutenant avait dû avouer qu’il restait encore des armes non détruites, à savoir celles qui se trouvaient dans la chambre de tir du bloc 1. La mitrailleuse et le canon en cet endroit ne défendait que l’accès immédiat au bloc et de plus, cette chambre, si elle restait intacte, était devenue totalement inaccessible à cause des éboulements, des fermetures des sas, des émanations de fumée toxique… Malgré ce fait, on lui ordonna de rester….
Voici sa dernière conversation téléphonique vers 04h00 du matin, le 19 mai 1940. Celle-ci adressée au colonel Aymé, commandant de l’infanterie de la 3e DIC (Division d’infanterie de forteresse), cela vers 04h00 du matin :
- « Avez-vous des armes en état de tirer des munitions ?
- Oui
- Bien. Dans ce cas, je n’ai pas besoin de vous rappeler votre devoir !
- J’ai compris. Adieu non colonel… »
Maurice Bourguignon choisit d’obéir aux ordres et ainsi accepta le sacrifice suprême de ses hommes et de lui-même. L’autre solution l’aurait fait passer pour un lâche. Même avec la conviction d’avoir sauvé ses hommes, et même, peut-être disculpé par le Conseil de Guerre, son honneur resterait entaché durant le restant de sa vie. L’officier, décida donc de rester dans son ouvrage. On imagine les terribles moments d’angoisse que ce choix entraîna. Il y eut sans doute les demandes et même supplications des sous-officiers à leur lieutenant. Dans le brouhaha, pour se faire entendre, il fallait à chaque fois soulever le masque pour se faire entendre malgré la fumée toxique s’épaississant de minute en minute dans toute la galerie ! J’imagine qu’on répéta plusieurs fois au lieutenant cette phrase : « Mon lieutenant, il faudrait absolument quitter l’ouvrage, tout est perdu, sauvons au moins les hommes ! ».
Vers 05h39, l’adjudant Sailly communique avec l’ouvrage du Chesnois. Il y a six heures que les hommes portent le masque, il n’y a plus de lumière… Ce sera la dernière communication téléphonique.
Pour tenir dans sa résolution d’obéir aux ordres, pour éviter de s’émouvoir encore plus de la souffrance de ses hommes, de leurs paniques, le lieutenant va s’enfermer dans sa chambre… Il s’installe sur sa chaise de bureau sans masque et attend sa fin, le même sort que ses hommes.
C’est là que les Allemands le retrouveront et, de là l’emporteront vers une fosse creusée à la hâte et qui demeurera longtemps inconnue. Le 9 juin, une compagnie disciplinaire allemande évacue 94 corps de la galerie entassés dans la galerie à partir de l’infirmerie et en dessous du bloc 1 (particulièrement au bout de celle-ci dans son prolongement contenant le tuyau d’évacuation des eaux sales : voir plan) et sous le bloc 1. Mais parmi les corps, on ne relève pas celui du lieutenant Bourguignon. C’est un drame pour toute sa famille car des bruits de comptoirs vont commencer à circuler aussi ridicules que celui prétendant que le lieutenant a pu fuir l’ouvrage. La famille est vite montrée du doigt ! Yves Bourguignon, le fils du lieutenant, consacrera une grosse partie de sa vie à résoudre la disparition des traces de son père et à mettre ainsi fin aux bruits les plus insensés. En 1973, intervient un fait décisif : il retrouve la trace d’un sous-officier de la compagnie disciplinaire allemande qui avait exhumé les corps de l’ouvrage le 9 juin, un nommé Wilhelm Peinemann. Ce dernier revient sur place et indique un lieu de sépulture passé inaperçu. Suite à ces indications, on entame le 9 juillet 1973 une fouille à l’arrière du bloc 2 dans laquelle sont retrouvés 17 corps dont ceux du médecin Fontaine et ceux du lieutenant Bourguignon. Le calvaire de la famille Bourguignon vient de cesser, 33 ans après le drame !

© Vince, Linkmimi,
Ajouter un commentaire
Commentaires
L’une des visites les plus belles et émouvantes que j’aie jamais faites.
La visite guidée de deux heures est très bien organisée et vraiment passionnante : tout est expliqué dans les moindres détails, sans jamais être lourd ou ennuyeux. C’est impressionnant d’entrer dans l’ouvrage, de parcourir le tunnel souterrain qui relie le bloc 2 au bloc 1, et de voir de ses propres yeux les lieux où les soldats français ont vécu pendant plusieurs mois.
La jeune femme à l’accueil était très gentille et disponible : elle a parlé en allemand avec mon ami et en anglais avec moi. Les toilettes étaient propres et le site est très bien entretenu.